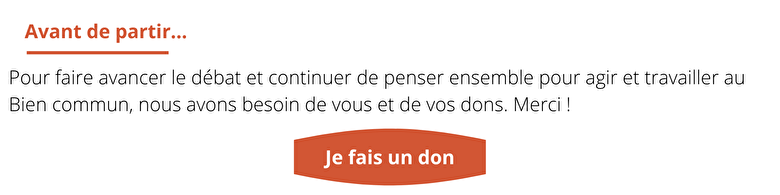On excusera à l’avance l’ambition du titre de cette tribune, démesuré au regard de la brièveté de l’argumentation. La question mérite d’être à nouveau sommairement abordée car pour la première fois à ma connaissance, elle s’inscrit pleinement dans les débats présidentiels. Au moins deux candidats, en l’occurrence des candidates, Christiane Taubira et Anne Hidalgo en ont fait un thème de leur campagne.
J’explique d’abord mes réserves à l’encontre des dispositions dites « facteur 20 » qui visent à ramener à un écart maximal de 1 à 20 les écarts de rémunérations (salaires et toutes primes liées au contrat de travail confondues) au sein d’une même entreprise ou de toute entité soumise à une politique salariale unique.
Sans préjudice du trouble apporté au régime de contrat salarial et du sentiment d’injustice ressenti par les cadres supérieurs, les effets secondaires de cette mesure seraient selon moi très négatifs, disproportionnés avec les bénéfices attendus. Les très grandes entreprises, seules concernées par cette mesure jouent un rôle important dans les négociations de branche ; le rôle des partenaires sociaux, non seulement dans les entreprises, mais aussi au niveau de la branche se trouverait affecté par l’intervention publique directe dans les négociations salariales, contrairement au principe de subsidiarité. En second lieu, les inégalités entre salariés ne seraient réduites qu’au sein des grandes sociétés. Le résultat global sur l’échelle des rémunérations pour la France entière est incertain. Ce qui est certain, c’est que les écarts de rémunérations entre les salariés appartenant aux catégories d’employés et d’ouvriers s’accroîtraient en accentuant la prime d’appartenance à un grand groupe[1]. Cela peut conduire les grandes sociétés à accélérer l’externalisation des tâches et le recentrage sur le cœur de métier, une des causes de l’augmentation des écarts salariaux et de la précarisation au cours des vingt dernières années, selon une étude récente de la Confédération européenne des syndicats[2].
Pour autant il ne s’agit pas de renoncer à accentuer le processus de réduction des écarts de rémunérations, en visant particulièrement les basses rémunérations. La pandémie, en soulignant l’utilité sociale de métiers et de tâches peu rémunérées ajoute à cet impératif. Cependant, considérant que notre pays n’est pas particulièrement mal placé en termes d’inégalités salariales et qu’on y observe même, toujours selon cette étude, une baisse des inégalités salariales[3], il faut chercher sans doute d’autres façons de traiter la question des inégalités salariales qu’une intervention drastique sur les revenus avant impôts.
Si le problème principal est celui du caractère disproportionné, voire scandaleux des rémunérations des cadres supérieurs et des mandataires sociaux dans les très grandes sociétés, alors mieux vaut prendre au mot les justifications que ces mêmes personnes avancent pour que de telles rémunérations « stratosphériques » leur soient attribuées : savoir qu’étant elles-mêmes à risque elles doivent pouvoir constituer une épargne importante. Soit, mais alors cette épargne devrait rester solidaire de l’entreprise qui lui a permis de se constituer. Une telle justification aurait le mérite de n’être pas punitive au regard de personnes qui estiment avoir mérité leur salaire. En pratique au-delà d’un certain seuil légal[4] (que je préfèrerais définir en valeur absolue et non proportionnellement au salaire le plus faible) le surplus de rémunération devrait en priorité abonder l’épargne longue de l’entreprise : soit de préférence le fonds salarial de l’entreprise (une pratique insuffisamment développée dans notre pays), soit les capitaux propres, à condition dans ce dernier cas que les stock-options ainsi obtenues soient conservées pendant une longue durée, y compris après le départ de l’intéressé. Ces deux modalités devraient porter remède au scandale répété des « retraites chapeaux ».
Si à l’inverse, la réduction des écarts salariaux vise le relèvement des bas salaires, on peut à nouveau se reporter à l’étude déjà citée de la Confédération européenne des syndicats. Celle-ci note d’abord que l’intégration européenne a contribué positivement à la réduction des écarts salariaux entre les pays, en faveur des pays ayant adhéré depuis 2004, ce qui est une bonne nouvelle dont on ne parle pas assez. Les écarts salariaux se creusent en Europe plutôt sous l’effet des écarts à l’intérieur des pays avec cependant quelques pays dont la France où ces écarts internes se sont réduits. La principale source d’accroissement des écarts provient partout de l’augmentation du différentiel, à qualification comparable, entre grandes et petites entreprises et ce sous l’effet des processus de recomposition qui conduisent à externaliser des tâches de service, de maintenance ou de sous-traitance à des entités moins soumises à des exigences contractuelles, c’est-à-dire échappant au dialogue social, voire bénéficiant d’exceptions au régime salarial de droit commun (plateformes ubérisées, secteurs bénéficiant d’exception au régime de limitation des CDD).
La même étude, décidément très riche, démontre aussi que les outils centraux de régulation des inégalités de rémunérations, tels que les législations sur le salaire minimum et la couverture des entreprises par des conventions collectives, jouent un rôle effectif et durable sur les écarts de rémunération comparés entre les pays. La conclusion de cela pour moi est claire : l’ajustement régulier du salaire minimum au-delà de l’inflation reste un instrument efficace de réduction des inégalités salariales, parallèlement à un encadrement strict des contrats précaires. Les négociations salariales dans le cadre d’accords de branches devraient jouer un rôle croissant dans cette perspective, soit par l’extension de ces accords aux zones grises de l’ubérisation, soit par leur meilleure application dans les branches qui bénéficient d’exemption à la législation, en particulier les branches des services rendus aux entreprises et aux particuliers.
Ainsi les thèmes de la négociation sociale, du bon équilibre entre le niveau de l’entreprise et celui de la branche, des conditions de la représentation syndicale, de la responsabilité sociale des grandes sociétés à l’égard des sous-traitants demeurent-ils essentiels à l’orée d’un prochain quinquennat alors que s’annoncent de grandes reconfigurations liées aux exigences de la transition environnementale.
[1] Face à cette objection des chercheurs ont proposé de créer une caisse nationale de compensation interentreprise pour reverser une part de la masse salariale perçue par les plus hauts salaires au bénéfice des salariés des trois premiers déciles. Voir « La protection salariale garantie « de Amin Mbarki, Samuel Tubiana et Anthony Pauline, Fondation Jean Jaurès. Outre l’extrême complexité du mécanisme , sa durabilité après quelques années est problématique.
[2] Wage inequality within and between firms-Macroeconomic and institutional drivers in Europe-2022.pdf, source European Trade Union Institute, étude signee de Wouter Zwysen, janvier 2022.
[3] Entre 2002 et 2018, les inégalités de rémunérations se seraient réduites de 20% mesurées par la variance des écarts, contre 8 % pour la moyenne de l’UE. Les inégalités ont surtout baissé dans les nouveaux Etats membres. Elles se sont accrues en RFA et dans la plupart des anciens Etats membres (sauf Be, Fr, UK).
[4] 300 000 euros net équivalent pas exemple à 20 fois le montant d’un SMIC annuel à temps complet. Il serait souhaitable de situer un plafond absolu de rémunérations en fonction d’une évaluation des besoins (consommation et épargne) selon une logique de comparaison entre les personnes de même statut social.
Jérôme Vignon, président d’honneur des SSF