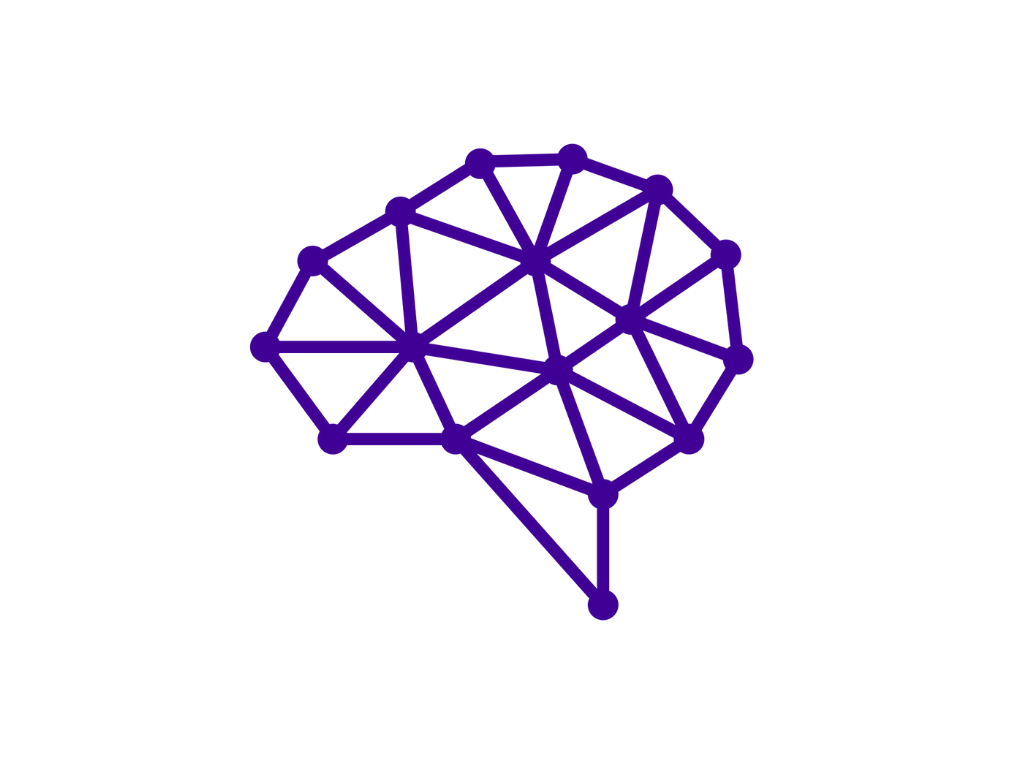Récemment les Ehpad ont fait l’objet de plusieurs articles relatant la difficulté croissante de recrutement de personnel soignant : aides-soignants et infirmières. Mal payés, mal considérés, harassants, ces métiers figurent dans le « top ten » des métiers en tension par l’étude annuelle de Pole emploi.
Faut-il, en cette circonstance, multiplier par deux le nombre de postes offerts comme le propose un groupe de députés de la majorité ? Au risque de multiplier d’autant les difficultés de recrutement ?
Ne s’agit-il pas plutôt d’un problème plus large dû à la culture dominante d’une société essentiellement technicienne et comptable qui a du mal à intégrer le « prendre soin » comme valeur fondatrice du vivre ensemble ?
Ne vaudrait-il pas mieux, pour inverser la tendance, prendre toute la mesure de cette déshérence dans laquelle se trouve le « prendre soin » et envisager un certain nombre de mesures portant sur l’ensemble du dispositif ?
Pour commencer il faudrait intégrer le « care », le prendre soin, dans la culture de la santé, ce qui, contrairement à tout bon sens, ne va pas de soi. Les études médicales notamment, valorisent le calcul et la rationalité aux dépens de cette culture du soin qui est pourtant leur fondement et leur finalité. On pourrait commencer par intégrer le prendre soin dans le cursus de toutes les études médicales et para médicales, avec, bien sûr, une partie pratique avec stages et, pourquoi pas, alternance. Mais pour ce faire, il faut renouveler en profondeur l’approche académique du «prendre soin » qui est trop souvent envisagée comme un aptitude naturelle ou, au mieux, ethnique (les très bonnes aides-soignantes sont souvent noires!) en intégrant dans l‘étude et l’apprentissage du prendre soin différents facteurs qui vont des techniques corporelles aux apprentissages comportementaux en passant par la prise en compte de la psychologie.
Mais on pourrait aussi intégrer la préoccupation du « prendre soin » dans un certain nombre d’études de pointe. On peut ainsi par exemple très bien imaginer que les exosquelettes développés pour l’infanterie américaine afin que les soldats puissent marcher très longtemps sans fatigue en portant des poids très importants soient adaptés aux aides-soignants, ce qui soulagerait toute une part de leur travail et éviterait les troubles musculo-squelettiques inhérents à ces métiers.
Il faut aussi penser au droit successoral. L’allongement de la durée de la vie conduit, de plus en plus souvent, à envisager une fin de vie coûteuse en terme de soins. Cette donnée nouvelle doit, de façon moins timide qu’actuellement, être intégrée dans le droit successoral. Peut-on, au-delà des récupérations sur successions, imaginer un système d’imposition permettant de réaliser une péréquation des ressources ?
Il faut aussi bien sûr penser à l’insuffisance des rémunérations de tous les métiers du soin, très souvent sous payés et sous évalués. Il y a là une question de reconnaissance tout à fait essentielle mais qui doit s’accompagner d’une meilleure connaissance et d’un plus grand apprentissage de la fonction du « prendre soin ».
On entend d’ici les critiques : quel sera le coût d’une politique pareille ? Économiquement parlant, cette question n’a pas grand sens. C’est l’activité qui créée la richesse, pas l’inverse. Il y a longtemps que ce sont les services échangés – et non plus les biens matériels produits – qui créent la richesse de nos sociétés. Si les aides-soignantes et les infirmières sont mieux payées, c’est en effet toute l’économie qui en profite car les salaires versés se transforment très vite en biens consommés. La seconde objection, plus juste, consiste à se demander : Qui va payer ? La logique de notre système sanitaire et social voudrait que ce soit la solidarité nationale qui prenne en charge, pour une grande part, ces dépenses. La création, repoussée puis remise en chantier, d’un cinquième risque constitue une occasion pour mettre cette question en débat.
Jean-Pierre Rosa