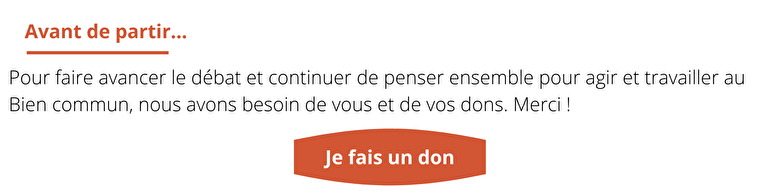« Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ? ». C’est la question titre de mon dernier livre. Et c’est aussi la question qui m’a porté aux Semaines Sociales dès 1995 et qui m’a habité tout au long des presque 20 ans que j’ai passé aux côtés de Jean Boissonnat, Michel Camdessus et Jérôme Vignon ensuite.
Nous avons passé quelques mois en confinement. Rien ne l’avait annoncé. Rien ne nous y avait préparés. Nous avons tous réfléchi au pourquoi. Certains y voyant une crise de la mondialisation ou du capitalisme. D’autres un complot chinois ou américain. Surtout nous avons réfléchi au monde d’après. Serait-il le monde d’avant en pire ? Ou serions-nous capables d’esquisser quelque chose de nouveau et attrayant ?
C’est dans ce contexte que j’ai pris la plume. Tous les jours j’ai écrit une pensée en un maximum de 1300 signes. Comme un journal de mes idées vagabondes. Et tous les jours j’ai essayé aussi d’organiser ma réflexion. Mon livre est né de cette séquence. Il suit mon précédent – Money Honnie, et si la finance sauvait le monde ?- dans lequel j’exprimais un certain enthousiasme après les échéances historiques de 2015 : sommet des Nations Unies à New York sur les objectifs du Développement Durable puis sommet de Paris en Décembre sur le Climat. Nous allions changer le monde. C’était écrit. J’en étais et j’y croyais. Puis les années passent. Des avant la crise du Covid le doute s’est installé. Etions nous « sérieux ? Voulions-nous « sérieusement » changer le monde ?
Bien sur nous en parlions davantage. Les enjeux environnementaux et sociaux restaient au premier plan. Incendies, catastrophes naturelles d’une part. Envol des populismes. Révoltes et hausse des inégalités d’autre part devenaient préoccupantes. Mais nous nous étions remis de la crise financière. Nous avions consolidé le système. Nous n’étions pas morts. Et la croissance – notre boussole – tenait bon. Nous regardions un verre et ne savions pas décider s’il était à moitié vide ou à moitié plein.
Le Covid a percuté nos certitudes. Ce n’est pas un phénomène nouveau. Des pandémies il y en a eu sous toutes les latitudes et à tous les siècles. J’avais été mobilise sur la précédente, Ebola, heureusement contenue. J’avais entendu Bill Gates nous alerter à ce moment-là. J’avais classé le risque entre cybersécurité et géopolitique. Inquiet bien sûr mais pas affolé.
Et voilà que cette nouvelle crise vient heurter nos pays et nos économies. Et jeter un coup de projecteur sur les failles non traitées de notre système. Nous avions choisi en 2015 une magnifique feuille de route mais n’avions pas suffisamment réfléchi aux implications. Si nous souhaitions une économie durable inclusive et résiliente que devions-nous faire ? Était-il raisonnable de ne pas interroger les fondamentaux de notre modèle depuis 50 ans ?
« Il ne s’agit pas de condamner le profit mais de le remettre à sa place essentielle mais différente. »
L’essentiel repose sur une formule fameuse du grand économiste Milton Friedman dans un article du New York Times de septembre 1970 : « la responsabilité sociale de l’entreprise est d’augmenter son profit ». Sur ces bases nous avons fait reposer nos normes comptables, nos modes de rémunération, la gouvernance des entreprises, les obligations de ceux qui gèrent notre argent … Bien sûr je simplifie un peu mais pas tant que ça. Nous avons érigé le profit comme fin en soi. Cela a marché un temps et il ne faudrait pas l’oublier. Mais nous avons touché les limites. Dans la sphère financière il y a 10 ans et plus largement comme nous commençons à le percevoir aujourd’hui. Il ne s’agit pas de condamner le profit mais de le remettre à sa place essentielle mais différente. Selon la belle formule de Colin Maier, professeur à Oxford : la responsabilité sociale de l’entreprise doit devenir de trouver des solutions profitables aux problèmes de notre planète et de ses habitants. Le profit est un moyen en vue d’une fin. Cela veut dire repenser son mode de calcul. Et surtout sortir la trousse à outils et réfléchir à nos normes de toutes natures. Cela signifie aussi réveiller le marché lui-même c’est-à-dire chacun d’entre nous, tour à tour consommateur, investisseur, salarié, chef d’entreprise militant, et naturellement citoyen. Si nous ne clamons pas nos envies et nos limites le système n’évoluera pas. C’est la belle formule de Tolstoï : « chacun pense à changer le monde mais personne ne pense à se changer soi-même ».
Ce n’est pas s’interroger sur le « que faire » qui compte mais bien se mettre à la tâche. Avec humilité et ambition. En retroussant nos manches. Tout cela a germé pour moi aux Semaine Sociales de France. Ma gratitude est infinie.
Bertrand Badré, ancien Directeur général à la Banque mondiale, Fondateur et Directeur général du Fonds Blue Like An Orange Sustainable Capital, ancien trésorier des Semaines sociales de France.